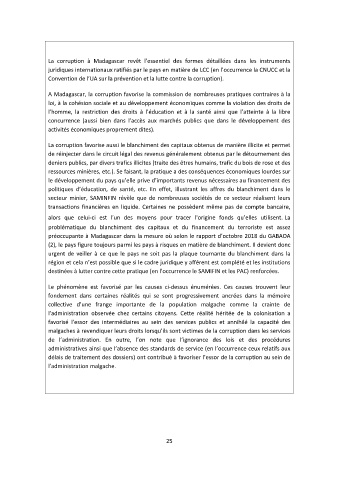Page 147 - SNLCCCSI 2020
P. 147
La corruption à Madagascar revêt l’essentiel des formes détaillées dans les instruments
juridiques internationaux ratifiés par le pays en matière de LCC (en l’occurrence la CNUCC et la
Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption).
A Madagascar, la corruption favorise la commission de nombreuses pratiques contraires à la
loi, à la cohésion sociale et au développement économiques comme la violation des droits de
l’homme, la restriction des droits à l’éducation et à la santé ainsi que l’atteinte à la libre
concurrence (aussi bien dans l’accès aux marchés publics que dans le développement des
activités économiques proprement dites).
La corruption favorise aussi le blanchiment des capitaux obtenus de manière illicite et permet
de réinjecter dans le circuit légal des revenus généralement obtenus par le détournement des
deniers publics, par divers trafics illicites (traite des êtres humains, trafic du bois de rose et des
ressources minières, etc.). Se faisant, la pratique a des conséquences économiques lourdes sur
le développement du pays qu’elle prive d’importants revenus nécessaires au financement des
politiques d’éducation, de santé, etc. En effet, illustrant les affres du blanchiment dans le
secteur minier, SAMINFIN révèle que de nombreuses sociétés de ce secteur réalisent leurs
transactions financières en liquide. Certaines ne possèdent même pas de compte bancaire,
alors que celui-ci est l'un des moyens pour tracer l'origine fonds qu’elles utilisent. La
problématique du blanchiment des capitaux et du financement du terroriste est assez
préoccupante à Madagascar dans la mesure où selon le rapport d’octobre 2018 du GABAOA
(2), le pays figure toujours parmi les pays à risques en matière de blanchiment. Il devient donc
urgent de veiller à ce que le pays ne soit pas la plaque tournante du blanchiment dans la
région et cela n’est possible que si le cadre juridique y afférent est complété et les institutions
destinées à lutter contre cette pratique (en l’occurrence le SAMIFIN et les PAC) renforcées.
Le phénomène est favorisé par les causes ci-dessus énumérées. Ces causes trouvent leur
fondement dans certaines réalités qui se sont progressivement ancrées dans la mémoire
collective d’une frange importante de la population malgache comme la crainte de
l’administration observée chez certains citoyens. Cette réalité héritée de la colonisation a
favorisé l’essor des intermédiaires au sein des services publics et annihilé la capacité des
malgaches à revendiquer leurs droits lorsqu’ils sont victimes de la corruption dans les services
de l’administration. En outre, l’on note que l’ignorance des lois et des procédures
administratives ainsi que l’absence des standards de service (en l’occurrence ceux relatifs aux
délais de traitement des dossiers) ont contribué à favoriser l’essor de la corruption au sein de
l’administration malgache.
25