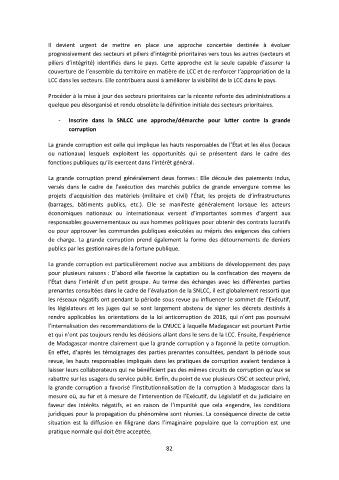Page 81 - SNLCCCSI 2020
P. 81
Il devient urgent de mettre en place une approche concertée destinée à évoluer
progressivement des secteurs et piliers d’intégrité prioritaires vers tous les autres (secteurs et
piliers d’intégrité) identifiés dans le pays. Cette approche est la seule capable d’assurer la
couverture de l’ensemble du territoire en matière de LCC et de renforcer l’appropriation de la
LCC dans les secteurs. Elle contribuera aussi à améliorer la visibilité de la LCC dans le pays.
Procéder à la mise à jour des secteurs prioritaires car la récente refonte des administrations a
quelque peu désorganisé et rendu obsolète la définition initiale des secteurs prioritaires.
- Inscrire dans la SNLCC une approche/démarche pour lutter contre la grande
corruption
La grande corruption est celle qui implique les hauts responsables de l’État et les élus (locaux
ou nationaux) lesquels exploitent les opportunités qui se présentent dans le cadre des
fonctions publiques qu’ils exercent dans l’intérêt général.
La grande corruption prend généralement deux formes : Elle découle des paiements indus,
versés dans le cadre de l’exécution des marchés publics de grande envergure comme les
projets d’acquisition des matériels (militaire et civil) l’État, les projets de d’infrastructures
(barrages, bâtiments publics, etc.). Elle se manifeste généralement lorsque les acteurs
économiques nationaux ou internationaux versent d’importantes sommes d’argent aux
responsables gouvernementaux ou aux hommes politiques pour obtenir des contrats lucratifs
ou pour approuver les commandes publiques exécutées au mépris des exigences des cahiers
de charge. La grande corruption prend également la forme des détournements de deniers
publics par les gestionnaires de la fortune publique.
La grande corruption est particulièrement nocive aux ambitions de développement des pays
pour plusieurs raisons : D’abord elle favorise la captation ou la confiscation des moyens de
l’État dans l’intérêt d’un petit groupe. Au terme des échanges avec les différentes parties
prenantes consultées dans le cadre de l’évaluation de la SNLCC, il est globalement ressorti que
les réseaux négatifs ont pendant la période sous revue pu influencer le sommet de l’Exécutif,
les législateurs et les juges qui se sont largement abstenu de signer les décrets destinés à
rendre applicables les orientations de la loi anticorruption de 2016, qui n’ont pas poursuivi
l’internalisation des recommandations de la CNUCC à laquelle Madagascar est pourtant Partie
et qui n’ont pas toujours rendu les décisions allant dans le sens de la LCC. Ensuite, l’expérience
de Madagascar montre clairement que la grande corruption y a façonné la petite corruption.
En effet, d’après les témoignages des parties prenantes consultées, pendant la période sous
revue, les hauts responsables impliqués dans les pratiques de corruption avaient tendance à
laisser leurs collaborateurs qui ne bénéficient pas des mêmes circuits de corruption qu’eux se
rabattre sur les usagers du service public. Enfin, du point de vue plusieurs OSC et secteur privé,
la grande corruption a favorisé l’institutionnalisation de la corruption à Madagascar dans la
mesure où, au fur et à mesure de l’intervention de l’Exécutif, du Législatif et du judiciaire en
faveur des intérêts négatifs, et en raison de l’impunité que cela engendre, les conditions
juridiques pour la propagation du phénomène sont réunies. La conséquence directe de cette
situation est la diffusion en filigrane dans l’imaginaire populaire que la corruption est une
pratique normale qui doit être acceptée.
82